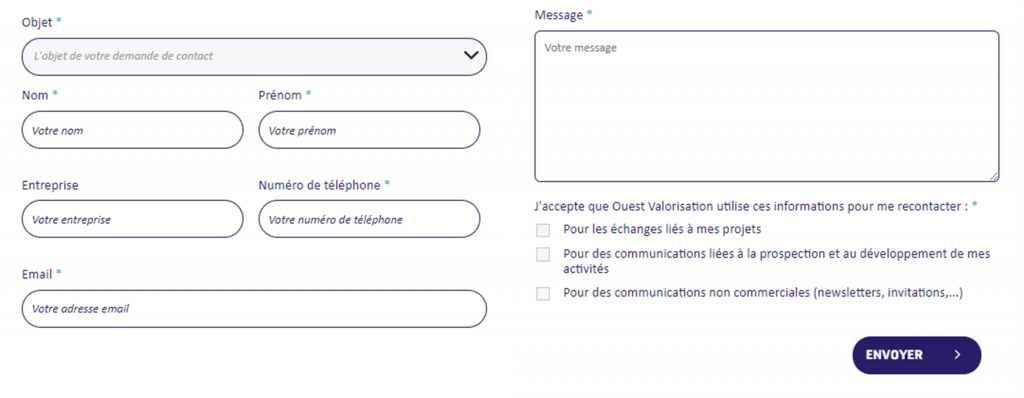Boostez votre compétitivité en accédant facilement aux compétences et équipements de laboratoires de l’Université Bretagne Sud (UBS)
Ouest Valorisation vous propose de faciliter votre accès aux compétences et équipements de laboratoires et plate-forme de l’UBS afin de booster votre capital R&D.
Notre offre :
- Réalisation de prestations de R&D
- Consultance scientifique
- Développement d’une mission de formation sur-mesure en entreprise
Les laboratoires et plate-forme
[avec logos et liens vers les sites web]
Les + UBSIDE
- Un interlocuteur unique, trait d’union entre vous et le savoir-faire breveté de l’UBS
- Un service complet et 100% sur-mesure
- La rédaction et négociation de contrats de prestation
- Un accès facile et rapide aux ressources technologiques et compétences des laboratoires et plate-forme de l’UBS
- Un agrément CIR et CICO
- Des formations à la carte, adaptées à vos besoins mêmes complexes
Les domaines d’intervention
[Avec les icones et prévoir possibilité de mettre liens vers pages explicatives]
- Biosynthèse et biodégradation des matériaux
- Intelligence embarquée
- Mise en œuvre des matériaux
- Stockage d’hydrogène
- Data sciences
- Génie des procédés alimentaires
- Cybersécurité
- Jumeau numérique